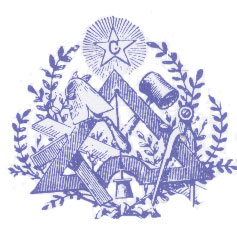LES PROCESSUS DE CIVILISATION SONT-ILS CONSUBSTANTIELS AUX VALEURS ?
Dans cette question qui nous est posée, tous les termes méritent une clarification, d’abord le terme civilisation qui en est le pivot central ; mais également le mot processus avec lequel il a partie liée pour former cette expression en forme de complément du nom. Il faudra également s’appesantir sur le mot valeur, constituant le deuxième pilier sur lequel s’articule notre interrogation. Enfin, il conviendra également d’expliciter l’adjectif consubstantiel reliant ces deux axes.
INTRODUCTION
« Nous autres, civilisations, nous savons maintenant que nous sommes mortelles ». C’est ainsi qu’au sortir du 1er conflit mondial, épouvanté par les conséquences du désastre, un écrivain et essayiste déjà fort célèbre, Paul Valéry, témoignait de son désarroi par ce mot resté fameux. (Faisons remarquer que, dans cette phrase, le mot civilisations est employé au pluriel, ce sont bien les civilisations dont il est question dans l’optique de Valéry).
Que voulait précisément souligner l’essayiste par cette formule lapidaire ? Le mot maintenant utilisé dans ce propos indique que, selon lui, jusqu’à ce jour, jusqu’à cette hécatombe et ces millions de morts, nous avions vécu dans l’illusion d’une stabilité perpétuelle, d’une assise ferme et indestructible de notre civilisation. Ou bien a-t-il voulu mettre en exergue le mirage qui est le nôtre d’une marche continue, régulière dans ce qu’on nomme souvent le progrès de la civilisation ? Mais pourquoi a-t-il utilisé le pluriel ? Qu’entendait-il au juste par civilisations au pluriel ? De quelles civilisations parle-t-il ? De la Civilisation française ? Ou Allemande ? Mais existe-t-il réellement une civilisation française, pouvant être apposée à une civilisation allemande ? Valéry vise-t-il la civilisation européenne ? Ou celle qualifiée d’occidentale, opposée à une autre qui serait alors dite orientale ou tout au moins non-occidentale? Veut-il parler de la civilisation mondiale ? Mais existe-t-il une civilisation mondiale ? D’autre part, Valéry pouvait-il ignorer que de nombreuses civilisations, au fil de l’histoire, ont disparu et qu’au cimetière des civilisations les pierres tombales, à demi effacées, sont foison ? Il y a là autant de questions propres à alimenter notre perplexité et à susciter notre curiosité.
QUE DOIT-ON ENTENDRE PAR CIVILISATION OU « CIVILISATIONS »?
Certes, il est notoire que le mot civilisation recouvre des notions fort peu claires, surtout lorsqu’on cherche à dépasser l’immédiateté des évidences trompeuses. Ouvrons l’Encyclopædia Universalis : « Le mot civilisation, nous est-il dit, est employé en des sens très variés et souvent fort imprécis ». Le Dictionnaire Culturel en Langue Française, sous la direction d’Alain Rey, souligne pour sa part : « Les ambiguïtés toujours nombreuses » que ce terme recouvre. Le Dictionnaire de L’Ethnologie et de l’Anthropologie n’est pas en reste lorsqu’il mentionne « Le dédoublement sémantique caractéristique de ce terme, qui peut avoir (1 )un sens très différent, voire antinomique, selon qu’il est employé au singulier ou au pluriel ». Il faudrait donc être très prudent et circonspect lorsqu’on emploie le mot civilisation, mot dont la signification est à géométrie variable et dont l’usage est susceptible d’entraîner des méprises parfois considérables. Souvenons-nous de cette assertion naguère assénée tout de go selon laquelle l’homme africain n’est pas encore ou suffisamment entré dans l’histoire. De là à conclure qu’il n’est pas encore assez civilisé, que sa civilisation est restée rudimentaire, il n’y a qu’un pas que certains se sont empressés de franchir allègrement puisque l’aval venait de très haut.
Notons d’emblée la relative jeunesse de ce mot civilisation, apparu dans notre langue en 1770, précédant de deux décennies seulement la Révolution. Ainsi Le F M Montesquieu ne l’aurait pas compris et n’aurait su l’utiliser. Ce mot, formé à partir de l’adjectif civil, lui-même dérivant du verbe civiliser, comme tous ceux de cette même famille nombreuse proviennent du latin Civis « le citoyen ». La civilisation serait alors, en quelque sorte et au sens propre du mot, l’aboutissement de la citoyenneté. Avant le 18ème siècle, le substantif de cette série est civilité, mot qui s’est d’abord appliqué à une communauté organisée autour d’un patrimoine commun, avant de désigner l’ensemble des convenances, des bonnes manières, en usage dans un groupe social donné déterminant les règles élémentaires du savoir-vivre, propres à cette collectivité. D’ailleurs, en italien, civiltá, proprement civilité, répond à notre mot civilisation. Ainsi la civiltá cinese, se traduit par, « la civilisation chinoise ».
La définition propre du mot Civilisation n’est donc pas une chose fort aisée. Une première approche consisterait à dire que ce mot désigne, « L’ensemble des caractères communs aux vastes sociétés les plus complexes ; ensemble des acquisitions des sociétés humaines » (Alain Rey). Mais cela exclurait des sociétés restreintes, réduites à quelques tribus, à quelques familles, ou isolées parce qu’insulaires. Devrait-on alors considérer ces groupes humains comme dépourvus de civilisation, ou ayant une civilisation moins développée, voire à l’état embryonnaire ou rudimentaire. Cela justifierait alors qu’on s’ingénie à leur apporter la civilisation, sous-entendu la nôtre, considérée comme plus vraie, plus performante ou plus complète. Cette conception, tout au long du 18ème et plus encore des 19ème et 20ème siècles, a permis de justifier la colonisation avec son corollaire l’esclavage et le détournement des richesses. Là encore, la notion n’est pas neutre. Rappelons les débats passionnés d’il y a quelques an nées sur l’idée de faire apparaître dans les manuels d’histoire scolaires la considération « des apports positifs de la colonisation ». C’est pourquoi, concernant la civilisation, il faut toujours faire la part du jugement de valeur implicite que ce mot induit et tâcher de parvenir à élaborer un jugement de réalité. Faute de quoi, dira-t-on que toutes les civilisations ne se valent pas, qu’il n’y a pas d’équivalence entre-elles, que certaines sont supérieures à d’autres qui leur sont inférieures ? On pourra même envisager un « Choc des civilisations ». Samuel Huntington, l’inventeur de cette notion l’explicite ainsi :
« Dans ce monde nouveau, la source fondamentale et première de conflit ne sera ni idéologique ni économique. Les grandes divisions au sein de l’humanité et la source principale de conflits seront culturelles. Les États-nations resteront les acteurs les plus puissants sur la scène internationale, mais les conflits centraux de la politique globale opposeront des nations et des groupes relevant de civilisations différentes. Le choc des civilisations dominera la politique à l’échelle planétaire. Les lignes de fracture entre civilisations seront les lignes de front des batailles du futur ». (2)
Une autre définition a été proposée. Ce serait « L’Ensemble de phénomènes sociaux à caractères religieux, moraux, esthétiques, scientifiques, techniques, communs à une grande société ou à un groupe de sociétés » (Alain Rey). Ainsi définie la civilisation se confond alors avec la culture, mais, tandis que la civilisation met l’accent sur les aspects matériels et concrets, en suggérant l’idée d’une progression, d’une accumulation des acquis au cours du temps ; la Culture quant à elle, concernerait les aspects intellectuels et moraux caractérisant un groupe humain. Ce sont les penseurs allemands de la fin du 19ème siècle qui sont à l’origine de cette distinction opposant les éléments matériels pouvant être soumis à croissance et évolution, aux éléments abstraits, intellectuels et moraux, jouissant d’une fixité ou d’une plus grande stabilité au fil du temps. Alors que les éléments matériels et concrets, caractérisant une civilisation, sont soumis à l’histoire, les éléments abstraits semblent échapper à l’évolution et transcender l’histoire, ils constitueraient alors la culture.
Cette distinction entre culture et civilisation est passée dans l’aire anglo-saxonne, dans laquelle on a vu apparaître, au cours du 20ème siècle, une nouvelle discipline, l’anthropologie culturelle, laquelle va évacuer progressivement le vocable civilisation pour ne conserver que celui de culture. On pourra ainsi parler de culture mélanésienne, culture aborigène, culture des bororos, des précolombiens, etc. Tout l’œuvre de Claude Lévi-Strauss repose sur l’étude analytique des cultures considérées comme des systèmes aux structures complexes (Parenté, mythes, répartitions des tâches domestiques, organisation de l’habitat…).
La civilisation enfin, en un dernier sens, c’est aussi l’ensemble des faits sociaux caractérisé par un élément dominant qui en est le trait fondamental le plus saillant. On parlera alors de civilisation du Fer, du Bronze, de la Céramique, du Renne, du Riz, du Maïs… Ce pourra être un lieu précis et circonscrit dans le l’espace avec une tendance à la généralisation : Civilisation du Magdalénien, du Solutréen, de Neandertal, de Cro-Magnon, du Mont Carmel… (Remarquons que, la mode de l’anthropologie culturelle se généralisant, on parle aussi, dans ces cas de cultures).
Mais une civilisation peut aussi prendre comme caractéristique principale une aire géographique définie ou une période historique précise, les deux étant plus ou moins vaste vastes. On pourra ainsi parler de la Civilisation de l’Orient ancien, Civilisation de l’Égypte pharaonique, Civilisation du Mexique précolombien, Civilisation de l’Inde ancienne… Cette caractéristique peut aussi référer plus spécifiquement à une période définie de l’histoire. On parlera alors de Civilisation de l’Occident médiéval, Civilisation de la Renaissance, Civilisation de la Révolution française, Civilisation de l’Europe classique…1
LA NOTION DE « PROCESSUS DE CIVILISATION »
On doit au sociologue allemand, Norbert Elias (1897-1990), cette expression utilisant le mot processus par décalque du titre de son ouvrage de référence Über den Prozeβdes Zivilisation (1939), proprement : À propos du processus de civilisation. Malheureusement, la traduction en français de cet ouvrage majeur a fait disparaître cette notion de processus qui constitue le cœur de l’analyse. Cette traduction en français a été éditée en deux tomes distincts, parus à des
1Toutes les mentions de ce paragraphe sont autant de titres d’ouvrages empruntés à la collection intitulée précisément Les Grandes Civilisations, des Éditions Arthaud. (3 )
dates différentes: La civilisation des mœurs (1973) et La dynamique de l’Occident (1977). Ce décalage dans le temps et ces titres innovants ont fait perdre l’unité d’ensemble de l’ouvrage telle que l’avait voulue son auteur. Néanmoins, ces deux titres français donnent une idée de la conception de Norbert Elias et énoncent sa thèse de base. En effet, c’est bien au niveau des mœurs, entendues au sens large de comportements sociaux, que se manifeste une tendance dynamique propre à l’Occident, ou civilisation occidentale. Cette dynamique, toujours selon l’auteur, est moins perceptible, moins efficiente, moins explicite dans d’autres formes de civilisation dont l’ancrage sur le passé est tel qu’il empêche toute forme de processus de se manifester. Ces civilisations semblent ainsi suspendues dans l’immutabilité, pour ne pas dire l’immobilisme.
Pour mémoire rappelons ici que le mot mœurs en français vient du mot latin mos, moris, signifiant : usage, habitude, coutume, conduite, manière de se comporter, traditions. C’est de lui que provient notre mot « morale ». Ce latin mos traduit le mot grec έθος(Éthos), signifiant tout comme le précédent : coutume, usage, habitude, coutume de la cité. C’est ce vocable grec qui a donné notre mot français « éthique ». En effet, en grec ancien comme en grec moderne, notre mot morale n’a qu’une seule et unique traduction : ήθική(éthique). Comme quoi, entre l’éthique et la morale, contrairement à ce que d’aucuns voudraient nous donner à penser, il n’y a que l’épaisseur du passage du grec au latin et strictement rien d’autre. Morale ou éthique2, toutes deux n’ont d’autre fonction que d’énoncer les règles régissant les coutumes collectives et d’établir des prescriptions appelées à réguler les mœurs devenant ainsi des normes de conduite.
Venons-en, à présent, à la notion de processus. Celle-ci implique une relation au temps. Il y a processus lorsqu’on peut constater, dans la successivité d’un ensemble d’actes, de gestes ou d’opérations, une différence quantitative ou qualitative en référence au temps qui s’est écoulé. En d’autres termes, lorsqu’entre l’instant T0 et l’instant T1, on note qu’un élément, ou un ensemble d’éléments ont subi une modification observable ou un changement quantifiable.
Ici, une remarque s’impose. Trop souvent, on assimile processus à progrès, et le changement constaté, ainsi que cela vient d’être dit, comme étant toujours favorable et positif. C’est là une illusion, c’est d’ailleurs ce qu’on a pu reprocher à Norbert Elias qui n’aurait considéré qu’une face à la notion de processus, celle qui mène à un progrès et toujours vers une positivité. En réalité, un processus peut être favorable ou défavorable, positif ou négatif, de croissance ou de décroissance, d’acheminement vers une thérapeutique ou, au contraire, allant sur la voie de la pathologie. Effectivement, on peut aller vers un processus d’amélioration, de guérison ou, au contraire, vers un processus d’aggravation. Ainsi, il y a une grande différence entre une évolution et son contraire, une involution, les deux résultant d’un processus mais orienté en sens inverse. En résumé, toute différence constatée entre un instant T0 et un instant T1 n’est pas nécessairement et d’emblée un indice favorable de progrès positif, il est des cas bien nombreux ou un progrès se fait vers la négativité et la malignité. Ainsi une sclérose en
2 Là où Aristote faisait de l’Éthique, Cicéron faisait de la Morale, et tous deux parlaient de la même chose. Ces deux mots doivent donc être envisagés sous l’angle de la synonymie la plus stricte. Il est abusif et totalement absurde de vouloir les considérer sous l’angle de l’opposition, et faire de l’un le vocable noble (celui d’origine grecque bien entendu : Ah ! Pour l’amour du grec, souffrez qu’on vous embrasse, disait déjà Molière, avec ironie), tandis que l’autre serait le mot vulgaire ou roturier, qui plus est chargé de négativité. Pour ma part, je ne vois aucune différence de nature entre une céphalée et un vulgaire mal de tête pour ce qui est de la douleur qui irradie la partie supérieure de ma personne : l’un n’est pas moins ni plus douloureux que l’autre. Plus qu’un simple caprice de précieux (-se),j’y vois surtout un distinguo permettant à celui qui se considère comme un mandarin de se positionner au-dessus du commun.
plaques peut évoluer et son processus peut à terme s’avérer fatal. De même, une tumeur peut voir son processus évolutif s’orienter vers une malignité s’accélérant au fil du temps.
Il conviendra donc d’être forts circonspects lorsque nous parlons de processus de civilisation. Ne nous laissons pas engluer dans l’illusion précédemment dénoncée. Il y a peut-être, même au niveau des civilisations, des processus de dégénérescence, des effets pervers, des positions hautement négatives, des conséquences particulièrement délétères, sinon comment expliquer que nombre de civilisations aient disparu dans les replis de l’histoire de l’humanité ? À voir les choses depuis Sirius, il semble même qu’il y ait, à l’heure présente, plus de civilisations mortes que de civilisations encore vivaces sous notre Soleil, tout comme il y a plus de langues mortes que de langues encore en usage de nos jours. La même chose peut se dire des religions, des formes d’art, des mœurs en général comme de l’organisation des sociétés. Bref, tout ce qui constitue précisément une civilisation.
LA NOTION DE « VALEURS »
Là aussi, mais plus encore qu’avec le mot civilisation, nous avons affaire à un mot redoutable quant à sa signification. À lui seul, il révèle une pluralité déconcertante de sens, dont la plupart sont incompatibles entre eux. Le Dictionnaire culturel en langue française (Alain Rey) en recense pas moins de 15 significations différentes. Le monde des valeurs est prolifique, protéiforme, source de multiplicité ; au point que le philosophe Louis Lavelle (1883-1951) a pu écrire un monumental Traité des valeurs3. Sans être sûr de pouvoir tout mettre en ordre clair, tâchons au moins de ne pas le rendre notre propos trop obscur. Puisqu’il est question de valeur tâchons au moins de savoir de quelle valeur on parle.
Notons également que les valeurs peuvent subir un classement relativement les unes aux autres, de la plus haute à la plus faible ; de la plus universelle à la plus particulière, de la plus recherchée à la plus commune. On aurait ainsi une table des valeurs avec des correspondances, des liaisons, des suprématies voire des exclusives. Les valeurs pourraient alors se compléter, fusionner, coopérer, ou au contraire entrer en conflit (Antigone et Cléon, Rodrigue et Chimène, le Maréchal ou Jean Moulin, Dieu ou Mammon, crois ou meurs !, la vérité ou le compromis, les principes et la pratique,…ta mère ou moi !).
a) VALEURS MATÉRIELLES
La valeur c’est d’abord ce qui s’attache à un objet en tant que susceptible d’être désiré, échangé ou donnant lieu à une acquisition. Ainsi parle-t-on de la valeur d’un terrain, d’une maison, d’un vêtement, d’un bijou… On peut dire d’un objet qu’il a de la valeur, une grande valeur, peu de valeur ou aucune valeur. Comme la mesure de cette valeur se fait par la quantité de monnaie qu’il faut donner pour l’acquisition de l’objet, ici la valeur se confond avec le prix. Pourtant, si on devait suivre Nietzsche dans sa position tranchée : « Tout ce qui a un prix n’a pas de valeur ». L’inverse étant également vrai, un objet de très grande valeur n’a pas de prix. Ne
3 LAVELLE (Louis).- Traité des valeurs.- Paris, Presses Universitaires de France, 1991 (2ème éd.).- 2 volumes, 768 p et 576 p.
parle-t-on pas à ce sujet de valeur inestimable ou d’objet qui n’a pas de prix ? En effet, il serait particulièrement ridicule de demander combien coûtent la Pyramide de Chéops, le Château de Versailles ou la Muraille de Chine, tout comme l’Enterrement du Comte d’Orgaz du Greco, la Flûte Enchantée de Mozart ou la 9ème symphonie de Beethoven.
La valeur c’est aussi la qualité d’un bien ou d’un service fondée sur son utilité (valeur d’usage), ou sur le rapport de l’offre et de la demande (valeur d’échange), ou encore sur la quantité de facteurs nécessaire à sa production (valeur travail). On peut par ailleurs mettre en valeur un bien ou un objet en augmentant sa désirabilité. La valeur c’est aussi la qualité intrinsèque ou extrinsèque qui s’attache à un objet. Ainsi l’or, considéré comme étalon pour l’évaluation des échanges est considéré comme ayant une valeur intrinsèque, c’est une valeur sûre, voire une valeur refuge. Par contre le papier monnaie n’a pas de valeur en soi, il n’a qu’une valeur par référence ou extrinsèque, c’est une valeur fiduciaire. Un billet de mille francs n’a plus de valeur, hormis pour le collectionneur. Et que dire de la valeur qui s’ajoute à une valeur, telle la taxe à la valeur ajoutée (TVA) venue, dans nos républiques modernes, remplacer la gabelle et l’octroi (et autres prélèvements) des souverains honnis de l’ancien régime ?
Dans tous les cas précédents, la valeur peut être dite matérielle, car elle présuppose le support d’un bien concret ou d’un service réel auquel elle est reliée. Ainsi une chose aura une valeur fondée sur son utilité objective ou subjective et sur la facilité plus ou moins grande qu’on a de se la procurer.
b) VALEURS ASTRAITES OU INTELLECTUELLES
Ce type de valeur dépend d’un jugement porté sur un objet, une personne ou une action et qui souligne qu’ils sont plus dignes que d’autres de motiver notre intérêt, d’augmenter l’estime que nous leur portons ou l’importance que nous leur accordons. Ainsi dira-t-on que tel livre a une grande valeur lorsqu’il nous fournit des éléments nous permettant d’accroitre notre capacité de réflexion, ou nous procure une satisfaction d’ordre affectif. Flaubert, parlant précisément d’un de ses ouvrages écrivait : « Toute la valeur de mon livre, s’il en a une, sera d’avoir su marcher droit sur un cheveu, suspendu entre le double abîme du lyrisme et du vulgaire ». (Correspondance 20 mars 1852).
La valeur d’un propos relève de sa pertinence. De même un raisonnement aura de la valeur lorsqu’il emporte notre adhésion et nous semble présenter des garanties de véracité. La valeur d’une méthode scientifique résulte des conséquences favorables auxquelles elle conduit. De la même façon, la valeur d’une théorie dépend de la capacité qu’elle offre de pouvoir rendre compte d’un grand nombre de phénomènes disparates et de les rassembler sous une même explication cohérente. L’épistémologue Karl Popper dirait, quant à lui, que la valeur d’une théorie c’est sa résistance à la falsifiabilité, bien qu’en soi, une théorie scientifique soit par essence falsifiable et réfutable. Ce par quoi elle se distingue des théories idéologiques (Marxisme, psychanalyse, conceptions théologie s diverses…) lesquelles, à l’opposé, se présentent toujours comme une vérité immuable et d’emblée préparées à faire face aux critiques déstabilisatrices en se prémunissant a priori contre toute tentative de réfutabilité.
Dans un texte, la valeur expressive des mots, surtout en poésie, confère à ce texte sa portée évocatrice et la résonnance qu’elle établit avec le système de nos affects. Cette expressivité peut alors donner au texte une valeur universelle. C’est celle des grands textes qui émaillent le
6
déroulement de l’épopée humaine depuis ses débuts dans les mondes sumérien, pharaonique, indien ou hébraïque… Ces textes ont su, au fil du temps, modeler nos façons de penser.
c) VALEURS MORALES
Comme le rappelle Alain : « Valeur, au sens plein signifie courage… Toutefois, la probité, l’intelligence, la mémoire, la santé, la force sont encore des valeurs. Toutes les vertus sont des valeurs… Le beau est encore une valeur » et, poursuit le moraliste : »On appelle valeur, tout ce qui donne puissance à l’homme pour exécuter », autrement dit pour agir. L’homme valeureux, c’est l’homme courageux, c’est celui qui s’engage dans l’action. C’est ainsi que Corneille fera dire à Rodrigue : « La valeur n’attend pas le nombre des années ! »
Dans cette rubrique nous pourrions, en complétant la liste donnée par Alain, y ranger l’honnêteté, l’altruisme, la sagesse, la générosité, la compassion, la pitié, l’amour sous toutes ses formes, la vertu, la volonté bonne au sens kantien du terme, le souci de la vérité, le dévouement, la fermeté d’âme, l’estime de soi, le jugement droit, la coopération, l’abnégation, l’esprit d’équipe. On peut aussi y inclure, la valeur qui s’attache à une promesse ou à un serment. Cette valeur met en lumière une triple détermination : l’acte qui engage notre promesse, le lien qui s’établit entre le contractant et la personne à qui la promesse est faite, enfin, le temps plus ou moins long de l’accomplissement.
La liste ci-dessus n’est ni définitive ni close. On pourrait sans doute rassembler ces toutes ces valeurs morales en disant qu’elles constituent l’ensemble des qualités d’une personne dans le domaine intellectuel, moral, professionnel et civique. Ces valeurs peuvent être absolues et sont souvent tenues pour telles, ou relatives (« Vérité en deçà des Pyrénées, erreur au-delà », selon Pascal). Elles peuvent donner lieu à des changements en fonction du lieu ou de l’époque, voire, selon Nietzsche, aboutir à « une transmutation des valeurs ».
On le voit, le fondement même de la morale, c’est la promotion des valeurs et principalement leur mise en pratique. Ce qui définit la valeur d’un homme, ce qui permet de dire qu’il est vertueux, c’est le sens qu’il donne aux valeurs qu’il promeut et qu’il essaye de mettre en pratique, dans sa vie de tous les jours, au contact des autres hommes, et en s’inscrivant dans la durée.
Pour Kant, la valeur morale réside dans l’action accomplie par devoir, lorsque celui-ci répond à l’obligation qu’on s’impose dans son accomplissement. Cette action résulte alors de notre pleine et entière volonté. C’est elle qui nous détermine à agir par pur respect pour le devoir. Ainsi, pour lui, la bonne volonté constitue la valeur suprême, nécessaire et suffisante pour définir une action morale.
L’étude des valeurs au sens moral du terme, à l’instar de ce qui vient d’être dit pour Kant, s’appelle l’axiologie (du grec axios « qui vaut »). C’est la science et la théorie des valeurs morales. L’axiologie est à la morale ce que la métaphysique est à la physique. Rappelons qu’on ne doit tenir aucun compte de la fallacieuse argutie qui consiste à distinguer, voire à opposer, la morale et l’éthique (Kant, en établissant l’universalité comme critère de la valeur morale, fait-il de la morale ou de l’éthique ? Et Descartes, en énonçant les règles de sa morale provisoire? Ou encore Bergson, en écrivant Les deux sources de la morale et de la religion ?). Cette distinction n’est pas pertinente et n’a aucun fondement. Elle ne repose que
7
sur des mots et n’a de sens que pour des esprits avides d’arguties hasardeuses. Elle ne donne l’illusion de la profondeur de pensée que parce qu’elle n’est fondée que sur une confusion de mots dont va découler une imprécision dans la détermination de la notion.
d) VALEURS POLITIQUES
Sous cette rubrique, nous pourrons ranger les valeurs qui animent la vie collective, la vie de la Cité, celles qui engagent le citoyen et constituent le socle sur lequel s’édifient les modalités du vivre, non seulement ensemble, mais bien plus encore, en communauté. Ces valeurs, ce sont celles qui déterminent de quelle façon l’autorité est exercée par la distribution des différentes instances d’exercice du pouvoir. Plus que beaucoup d’autres elles doivent favoriser le partage, la mise en commun de nos pratiques et de nos actions. Ces valeurs doivent transcender les points de vue individuels et davantage nous ancrer dans le collectif.
Il est clair que le triptyque républicain est à ranger au premier chef dans cette catégorie. La liberté sous toutes ses formes est une valeur fondamentale : liberté de vote, de mouvement, d’expression, de croyance, de réunion, d’acquisition et de possession…
L’égalité est aussi une valeur principielle. Égalité devant la loi, devant la justice, dans l’expression du suffrage. C’est aussi l’égalité entre tous les citoyens, ce qui implique l’abandon de toute forme de discrimination liée au statut économique, à l’origine ethnique, au sexe, à la langue, au système de croyances. Lorsqu’on se réclame de l’égalité, cela implique qu’aucune personne ne puisse être mise à part (apartheid en hollandais), personne ne doit se voir écarté de l’exercice d’un droit quelconque.
La Fraternité est une valeur-frontière. Elle se tient entre les valeurs proprement politiques et les valeurs morales. La valeur de solidarité, sur un plan strictement politique, peut s’y substituer avantageusement, même si elle ne remplit pas parfaitement le rôle dévolu à la première.
La laïcité, en tant que non-ingérence du collectif dans les croyances personnelles et, en retour, comme non-intervention de celles-ci sur le collectif, constitue aussi une valeur. Sur le plan de la morale elle définit la tolérance, sur le plan plus politique, celui de la civilité, elle doit permettre d’écarter les positions personnelles qui pourraient freiner l’expression d’une opinion collective. Elle garantit également le respect réciproque des opinions individuelles.
L’idéal de justice, le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes et des richesses de leur sol comme de leur sous-sol, le souci de préserver l’environnement par une limitation des gaspillages sous toutes les formes, le fait d’éviter de porter atteinte de façon irrémédiable et irréversible à ce même environnement ; la gestion parcimonieuse, équilibrée et justement distribuée des richesses naturelles. Voilà autant de valeurs reconnues par beaucoup.
e) VALEURS ARTISTIQUES OU ESTHÉTIQUES
Ce sont ces valeurs qui définissent l’œuvre d’art en général ou qui résultent de l’effet d’une œuvre d’art sur notre sensibilité. Dans ce cas elles sont à l’origine du plaisir esthétique. Dans
8
cette rubrique, nous pourrons ranger la beauté, l’harmonie, la symétrie, l’élégance, l’équilibre des formes et des proportions, la perfection, le sublime, la pureté, le raffinement…
Ces valeurs viennent jouer avec notre sensibilité en y suscitant des sentiments assez diffus mais toujours empreints d’affects. Ce sont elles qui font jaillir nos émotions. Elles témoignent de notre aptitude à réagir aux modifications de notre environnement considérées comme agréables.
Remarquons que les valeurs dont il vient d’être question ont pour fonction d’apporter un surcroît de possibilités. En somme il y a l’objet, considéré en sa matérialité (Une planche de bois ou une toile tendue présentant des formes et des couleurs, un geste ou un ensemble de gestes exécutés sur une scène, une succession de sons produits pas différents instruments et agencés d’une certaine façon, une voix modulant selon un rythme approprié…) et ce qui vient s’ajouter aux déterminations précédentes. Cet ajout constitue précisément la valeur esthétique de l’objet ou de la chose en question.
L’artiste, en tant que créateur d’œuvre esthétique est précisément celui qui, par son travail, mais plus encore par son talent, ajoute à l’objet inerte au départ une dimension nouvelle qui le rend objet esthétique, ou œuvre d’art en général. Par là, il est aussi le créateur de la valeur esthétique dont il a été question précédemment. D’un point de vue minimal on pourrait dire que l’artiste transforme la matière informe primitive pour lui donner la forme qu’il souhaite et qui lui conférera la dimension esthétique propre à l’œuvre d’art. Mais il serait plus approprié de dire qu’il est créateur de forme car sans lui, sans son action, l’œuvre n’existerait pas. Il ne s’agit point là d’un truisme ou d’une évidence proche d’une lapalissade. On peut même méditer à l’infini, tel Saint-Exupéry dans Terre des Hommes, être « tourmenté » comme lui, sur « ce Mozart assassiné », qui sommeille en tout homme mais qui disparaîtra, faute d’avoir pu bénéficier des possibilités de développer un talent créatif.
f) VALEURS SYMBOLIQUES
Ce type de valeur repose sur le fait de renvoyer une chose vers autre chose qui la représente ou auquel elle se rattache. Cette modalité répond ainsi au sens étymologique propre du mot symbole. C’est ce genre de valeur qu’on retrouve dans tous les signes allégoriques ou emblématiques tels le drapeau dont la valeur qui s’y attache ne dépend pas de la forme, des couleurs ou du dessin représenté lesquels ne sont que des adjuvants ou des éléments subalternes ; mais bien de ce qu’il signifie comme objet subsumant une période de l’histoire, des faits d’armes où la vie de combattants était en jeu. Il est l’indice révélant l’attachement d’une collectivité se reconnaissant en lui comme à son représentant. Bien mieux, il incarne l’âme de cette collectivité.
C’est cette même valeur symbolique qu’on retrouve dans les lieux, les objets, les personnes, les situations, les moments du temps qui ont la propriété de renvoyer à des souvenirs. Ces derniers peuvent être particuliers à un individu (Bijoux procédant d’un héritage de famille, photos ou objets de disparus chers, lieux d’anniversaires rappelant des événements heureux ou douloureux, objets ayant appartenu à des personnes proches ou simplement liés à notre enfance, une pierre tombale…). Ils peuvent aussi consister en des objets, des lieux ou des temps reconnus par une collectivité (Endroits de batailles, camps d’internement ou d’extermination, monuments identifiés à un événement précis, fêtes nationales, cérémonies
9
mémorielles, lieux chargés d’histoire justement appelés lieux de mémoire…). Notons au passage que ce genre de valeur présente un rapport plus ou moins direct avec la mort. La mort, en tant qu’événement physique est vouée à la disparition, à la dissolution, à l’anéantissement ; seule la projection dans une mémoire peut assurer la survivance, la permanence, dans un creuset qui n’est plus dans la réalité mais se situe sur un plan purement symbolique. Peut-être avec la mort a-t-on affaire au symbole des symboles, celui qui rattache une absence à une présence, qui renvoie un non-être vers l’être, une impermanence vers la permanence ; qui établit un passage d’une réalité inexistante à une réalité subsistante.
Cette valeur symbolique est particulièrement présente dans le phénomène étudié notamment par Marcel Mauss dans son Essai sur le don. Dans le don, si nous suivons l’éminent ethnologue, l’objet donné n’a qu’une importance subalterne dans sa pure matérialité, il renvoie en réalité à tout un contexte de relations sociales, ce qui en fait un échange éminemment symbolique. De même que l’adage courant selon lequel la façon de donner a plus de valeur que ce que l’on donne, l’étude du don, déjà dans des sociétés fort éloignées de la nôtre, montre l’importante attachée à la forme du don indépendamment de sa matérialité. Ce qui importe dans le don, c’est le système d’échanges auquel il est obligatoirement lié. Selon Mauss, tout don présuppose trois éléments successifs mais très imbriqués auxquels l’objet donné renvoie nécessairement. Il y a d’abord, évidemment, l’acte de donner, ce geste est fait par du donateur. Pour celui a qui le don est fait, le donataire, il y a ensuite l’obligation d’accepter ce don. Faute de quoi, en cas de refus, le donateur se sentirait profondément offensé. Bien des conflits ont pour origine un don méprisé ou plus grave, rejeté ou renvoyé. Refuser un don équivaut à nier le donateur, à lui dénier sa capacité à entrer en relation avec le donataire, c’est couper les ponts entre lui et moi. C’est, dans ce cas, la négation pure du lien social. Dans nos sociétés, pensons à un cadeau qui est fait et qui est refusé par celui à qui il est destiné. Enfin, troisième et dernier moment, mais très important également, il y a l’obligation pour le donataire de rendre au donateur un objet équivalent et mieux encore, supérieur. Ne pas rendre est considéré comme un manque de savoir-vivre en collectivité, c’est l’indice d’un égoïsme profond, une impossibilité de se rattacher à un réseau de relations sociales fondement du vivre ensemble. Dans notre société il est mal vu, par exemple, d’accepter une invitation à un repas sans, en retour, rendre cette même invitation. Recevoir un cadeau engage. Celui qui le reçoit doit, à son tour, offrir un cadeau en retour, soit, au moins, se montrer reconnaissant (dis merci et fais un bisou à Papy qui t’a fait ce si beau cadeau, et sois gentil avec lui !). Ainsi, le donataire devient à son tour donateur (un merci est déjà le premier signe de ce retour), le donateur initial se transforme alors en donataire et le processus d’échanges collectifs est amorcé, par un effet de boule de neige. Par le fait de renvoyer à autre chose qu’à lui-même, et d’impliquer plus que la simple matérialité. Ainsi, le don est bien une valeur symbolique essentielle4.
Dans cette rubrique, il convient de ranger les objets, les moments, les lieux, les personnes reliés à un système de croyances en général et constituant l’essence propre des faits religieux. La valeur reconnue s’attachant à ce genre d’êtres ne dépend que des croyances qui y renvoient.
4 En relation avec cette thématique du don, il s’est constitué tout un collectif de chercheurs en sciences sociales intitulé le M.A.U.S.S. Cet acronyme signifie Mouvement Anti-Utilitariste en Sciences Sociales, il renvoie au patronyme de l’illustre ethnologue Marcel Mauss, un des fondateurs de l’École Sociologique Française, avec son oncle Émile Durkheim. Outre la publication d’un bulletin semestriel, le M.A.U.S.S. publie aussi des essais dont la teneur consiste à montrer, contrairement à la tendance dominante de l’anthropologie culturelle anglo-saxonne, que les échanges au sein des sociétés humaines n’est pas seulement et exclusivement fondé sur des biens matériels mais surtout et principalement sur des échanges à valeur symbolique. L’utilitarisme, cher à Stuart-Mill qui avait déjà subi les critiques d’Adam Smith et de Ricardo entre autres, est incapable de rendre compte de cette valeur symbolique mise en exergue dans l’échange auquel le don participe et d’où résulte la possibilité de l’établissement des liens sociaux et leur renforcement.
C’est ainsi qu’on peut rendre compte de la sacralité caractéristique du monde religieux, quelle que soit la religion concernée. Lorsqu’un objet est tenu pour sacré dans un contexte religieux précis, c’est qu’on lui attribue une valeur qui le dépasse. Certains n’hésiteraient pas à dire qu’elle transcende l’objet en question, tellement cette valeur, pour le croyant, l’adepte ou le fidèle, semble dépasser la simple matérialité de la chose et se situer dans un arrière monde vers quoi il renvoie. C’est cela qui rend cette valeur totalement symbolique.
Le propre de la valeur symbolique, c’est de ne pas être matérielle en soi, bien que partant d’un support matériel et d’un contexte spatio-temporel. C’est aussi de dépasser la matérialité en y ajoutant une détermination nouvelle. Cette détermination n’a de sens que pour un être pensant susceptible d’être affecté par elle. En effet, la valeur symbolique a un rapport direct avec l’affectivité de l’homme, avec sa capacité à s’émouvoir, à ressentir, à imaginer ; en un mot à y trouver une signification dont il perçoit le retentissement en son for intérieur.
g) AUTRES FORMES DE VALEURS
Malgré le découpage précédent déjà fort prolifique, il existe un certain nombre de valeurs qu’il était difficile d’y inclure.
Il s’agit entre autres de la mesure ou la détermination conventionnelle attachée à un signe ou a un objet. Ainsi parle-t-on de valeur au sujet des cartes à jouer. Dans ce cas, une reine vaut plus qu’un valet et moins qu’un roi, mais le un ou as vaut plus que le dix et même qu’un roi. Cette valeur est fonction des règles du jeu, c’est ainsi qu’à la belote, le valet d’atout a une valeur prioritaire sur toutes les autres cartes du jeu, de même qu’une couleur d’atout bat toute autre carte d’une autre couleur quelle que soit sa valeur propre. Ici, c’est donc la règle du jeu qui fixe les valeurs et les répartit selon un code précis. Une carte n’a pas de valeur intrinsèque, elle n’est que le support d’une valeur que lui assigne la règle précise du jeu en question.
Il en va de même pour le jeu d’échecs. Ce sont les règles de ce jeu qui fixent le code des valeurs attribuées aux différentes pièces. Une fois fixée, pour une pièce donnée, cette valeur lui est propre. C’est cette valeur qui détermine ses possibilités de déplacement sur l’échiquier, ou ses interdictions ; de même que les prises qu’elle peut, ou ne peut pas, effectuer au cours de ces mêmes déplacements, en fonction des valeurs des autres pièces. Mais qui dit règle, dit aussi convention et celle-ci dépend de l’accord tacite que les joueurs passent entre eux au moment d’entrer dans le jeu. Quel que soit le jeu, jouer, c’est accepter de jouer le jeu, par conséquent c’est en admettre les règles, faute de quoi, aucun jeu ne serait possible. Le tricheur, c’est celui qui, bafouant les règles du jeu qu’il a feint d’accepter au départ, nie la valeur de ces règles ; ce faisant, il dénie à ses partenaires de jeu l’égalité qui s’était instaurée entre eux par la mise en jeu. Ainsi, il se coupe du réseau de relations sociales que le jeu présuppose et, au final, il est exclu du jeu.
En musique, la valeur des notes détermine la durée des sons dont on se sert pour les repérer et pouvant donner lieu à une lecture par la suite. Ainsi une blanche a une valeur double de la noire. La valeur d’une noire pointée a la valeur de trois croches. La valeur d’une ronde est équivalente à deux blanches, donc à quatre noires… Il en va de même pour la valeur des signes devant indiquer la durée des silences, ou pour celle des signes dièse, bémol ou bécarre affectant la valeur propre des notes. En fait, l’ensemble des signes musicaux n’est qu’une grande table des valeurs définissant une action ou un son à reproduire pour une exécution
11
future. Il est à noter que cette table des valeurs est purement conventionnelle et loin d’être universelle, contrairement à ce qui est dit parfois.
En linguistique, la valeur d’un signe du langage ou d’un mot résulte de son appartenance à une structure définie par le contexte dans lequel ce signe ou ce mot est utilisé. Par ailleurs la valeur d’un élément quelconque du langage découle de la position de cet élément dans le système linguistique considéré. Cette valeur s’oppose à la signification proprement dite du mot en lui-même. Ainsi le mot « beau », dans beau-père, dans beau-parleur, dans il a beau faire, dans un beau tableau, dans il est dans de beaux draps, dans porter beau, dans le grand beau, dans un beau matin, dans un beau rôle, dans le beau milieu… ne garde pas toujours la même détermination. Certains de ces usages ne sont pertinents que dans le système linguistique propre à la langue française et sont difficilement traduisibles ailleurs. De même, en phonologie, la valeur distinctive d’un phonème est fonction des phonèmes qui le suivent ou le précédent et avec lesquels il établit une opposition afin de s’en détacher, faute de quoi les sons de la langue seraient indistincts et la communication ne pourrait se faire.
EXIXTE-T-IL UN DÉNOMINATEUR COMMUN AUX VALEURS ?
Nous venons de le constater, d’après les rubriques précédentes, les valeurs se présentent à nous de façon fort disparate. Leur constellation est loin d’être uniforme et homogène. À première vue il n’y a rien, aucun facteur commun, qui puisse les rassembler sous une même bannière. En effet, que pourrait-il y avoir de commun entre par exemple les valeurs économiques et les valeurs esthétiques, certes une œuvre d’art est chère mais ce n’est pas parce qu’elle est chère qu’elle est une œuvre d’art. Sans doute, dans cette transaction fictive, on confond deux choses : d’une part, la valeur économique se traduisant par le prix et dépendant de l’offre et de la demande, du désir d’acquisition qui nous guide, du souci de distinction sociale que cette même acquisition nous procurerait, tout cela déterminant la quantité d’argent que nous sommes prêts à engager ; d’autre part, la valeur proprement esthétique de l’objet en question laquelle est sous la dépendance du style de l’artiste, de la mode ou du goût du moment, du snobisme d’une classe sociale, de l’indépendance du créateur… Il semble donc bien difficile d’établir des ponts et des passages entre les différentes valeurs.
Pourtant, ce que nous avons dit de ces mêmes valeurs esthétiques devrait nous livrer une première voie de solution. Nous avons vu que ces valeurs reviennent à ajouter un surplus de détermination à un objet ou à une situation lesquels, livrés à leur pure matérialité ne seraient que cela, comme le suggère Edmond Rostand dans ce vers : « Oh ! Soleil, toi sans qui les choses ne seraient que ce qu’elles sont ! ». Ainsi, une œuvre d’art serait une matière complétée par quelque chose dépassant la matière et qui est de l’ordre de l’impondérable. L’œuvre d’art, conçue en soi, serait donc une objectivité à quoi viendrait s’ajouter un surplus de détermination. Ce surplus proviendrait de la subjectivité.
Une deuxième dimension nous est offerte par les valeurs classées symboliques. Nous savons que ces valeurs renvoient toujours à autre chose qui les dépasse et qui est d’une autre nature. Leur fonction est de représenter autre chose qu’elles-mêmes. Une telle propriété pourrait-elle être généralisée à toute la gamme des valeurs précédemment répertoriées ? Une analyse plus
12
fine montrerait, sans doute, que cela est possible. Prenons les plus matérielles des valeurs, les valeurs économiques, et ce qui en est le parangon le plus évident : l’or. Qui pourrait nier que l’or, en plus de sa matérialité importante certes, n’a pas aussi une valeur symbolique ? En effet, ne représente-t-il pas l’inaltérabilité, la rareté, la puissance, la souveraineté, le soleil éclatant, la durabilité voire l’éternité ?
En joignant ces deux déterminations, nous pourrions alors dire des valeurs, de toute valeur, d’une part, qu’elles ajoutent une subjectivité à une objectivité, qu’elles créent un surplus d’être ; d’autre part, qu’elles renvoient à autre chose qu’elles-mêmes, qu’elles rendent présent un être en objectivant une subjectivité. En somme une valeur, c’est de l’être qui s’ajoute à l’être, c’est un surplus d’être. Si l’ontologie, selon la conception d’Aristote, est « la science de l’être en tant qu’être »; l’axiologie, pour sa part, serait alors la science de l’être qui s’ajoute à l’être. Science du surplus d’être, l’axiologie est comme une ontologie redoublée.
CONSUBSTANTIEL
Ce qui vient d’être dit concernant ce surplus d’être par lequel une valeur s’instaure, va trouver son explicitation plus complète si nous passons à l’examen de la substance, par l’intermédiaire de l’adjectif substantiel, d’où dérive le composé consubstantiel. Ce dernier terme fait partie des mots qui sont à définir dans la question qui nous est posée. Il est sans doute curieux de noter que ce mot appartient, au départ, au vocabulaire religieux spécifiquement chrétien. Il traduit le grec homoousios (de homo, le même, et ousia, essence ou substance) et fut adopté au concile de Nicée (325)5. Cet adjectif consubstantiel, inclus dans la formulation du Credo de Nicée, a eu pour fonction principale de définir l’unité parfaite et l’identité, non seulement spécifique mais « numérique », de substance, essence ou nature, entre Dieu le Fils et Dieu le Père. Plus tard il a été étendu au Saint-Esprit. Ainsi, les trois Personnes divines, réellement distinctes comme personnes, sont consubstantielles (une seule nature, substance ou essence mais trois manifestations ou hypostases)6. Ce terme consubstantiel s’appliquera aussi, bien que d’une façon un peu différente, à la définition de l’eucharistie. Il qualifie alors la présence réelle et simultanée du corps et du sang du Christ, substances purement abstraites et idéalisées, s’unissant intimement au pain et au vin en tant que substances matérielles. Cette interpénétration des substances qu’est proprement la consubstantialité définit, selon les Luthériens, l’eucharistie. Les Catholiques préférant, pour leur part, considérer l’eucharistie comme procédant de la transsubstantiation, faisant apparaître une substance autre, nouvelle, différente car modifiée par le seul sacrifice de la messe, sous l’action de l’officiant
5 Ce concile, convoqué par l’ordre de l’empereur Constantin, s’est tenu à Nicée, ville de la Turquie actuelle ayant pour nom Iznik. Il est considéré comme le premier concile réellement œcuménique car il réunit, pour la première fois, les Églises d’orient et celles d’occident. La raison d’être de cette convocation était de mettre fin aux dissensions nombreuses sur les points de doctrine entre les différentes régions de la chrétienté. Parmi les décisions conciliaires, notons la formulation d’une confession de foi définissant une orthodoxie au sein des croyances : ce fut le Credo de Nicée. Celui-ci, remanié, complété et mis en forme canonique par le concile de Constantinople (381), sera appelé le Symbole des Apôtres, encore en usage dans l’universalité des Églises chrétiennes. Le point d’achoppement était précisément cette notion de consubstantialité, incluse dans la formulation de ce credo mais refusée par les partisans d’Arius. Ceux-ci, considérés désormais comme hérétiques, à l’issue du concile de Nicée, se virent excommuniés de l’Église universelle.
6 Voir, Dictionnaire de la foi chrétienne, vol. 1, les mots.- Paris, Ed. du Cerf, 1968.- 837p.
consécrateur. Le pain de l’hostie a cessé du pain, c’est « le corps du christ », le vin du calice n’est plus du vin, mais son sang.
En passant dans le langage courant, l’adjectif consubstantiel a, comme souvent en pareil cas, perdu de sa force, son sens s’est édulcoré et fortement atténué. Il ne signifie plus tout à fait, selon une terminologie d’origine aristotélicienne, une identité ou une fusion de substances car, après tout, on ne sait plus trop bien ce qu’est une substance ; mais il signifie seulement une coexistence de deux ou plusieurs choses, chacune gardant sa spécificité. On peut aussi dire des choses qui coexistent qu’elles sont inséparables, en évitant de se pencher de trop près sur leurs substances respectives et supposées.
Dans notre question, il s’agira de savoir si lesdits processus de civilisation peuvent coexister avec les valeurs. En un sens un peu plus prononcé, peut-on dire que les premiers doivent être considérés comme inséparables des seconds ? Et si oui, à quelles conditions ?
RÉPONSE À LA QUESTION POSÉE
Les processus de civilisation sont-ils consubstantiels aux valeurs ? Telle était la question. La réponse semble aller de soi. Dans la mesure où une civilisation englobe une multiplicité d’éléments disparates et considérant que les valeurs constituent une constellation multiforme de déterminations, il semble évident qu’on doive de répondre par l’affirmative à cette question. Mais, aussitôt, on voit se lever un immense problème. De quelles valeurs parle-t-on en affirmant cette assertion ? Dans l’éventail des valeurs proposées, il semble que chaque civilisation a fait son choix, et ces choix ne sont ni identiques ni équivalents. Au supermarché des valeurs, chaque civilisation a sélectionné ses rayons de prédilection. Beaucoup de civilisations ont privilégié certaines valeurs, parfois en mettant à leur frontispice une valeur unique, au détriment des autres et même en excluant, en niant ou éliminant d’autres valeurs. Là où Athènes privilégiait le débat public, le suffrage direct, les valeurs esthétiques et morales (le kaloskagathos, le beau et bon comme idéal de l’homme de la polis, donc policé car vivant en civilité); au même moment, Sparte donnait la primauté aux vertus militaires, à l’éducation physique exclusive de tout autre, à la force primant sur le droit. Relisons, avec ce marque- page, les deux premiers livres de La République de Platon et on comprendra pourquoi, à la bataille qui mit fin à la guerre du Péloponnèse, en -404, on vit la chute d’Athènes soumise alors au joug de Sparte et la démocratie athénienne, avec toutes ses valeurs de civilité, succomber sous la ploutocratie spartiate. On comprendra surtout pourquoi Socrate dut boire le calice de cigüe jusqu’à la lie, cinq ans après, en -399. Que voulez-vous qu’une soldatesque fasse de sa maïeutique ? Face au musclé, le sage a peu de poids !
Qu’on étudie de près différentes civilisations et on verra combien ce qui est valeur pour l’une est délaissé par l’autre. Ainsi, la civilisation égyptienne, tout au long de sa longue histoire, a privilégié la primauté pharaonique censée incarner l’ordre cosmique, Pharaon est fils de Râ, le soleil. Son rôle est de garantir le culte de Maât, la déesse incarnant la justice, la vérité et plus généralement, le principe unificateur , éman ation de l’ordre dans l’univers. Dans cette civilisation, l’écriture avait pour fonction de rendre éternelle la manifestation de toute chose, de toute action, au regard de cet ordre cosmique. C’est pour cela que cette écriture était considérée comme formée de signes sacrés. Enfin, les crues du Nil, par leur régularité, leur
14
prévisibilité étaient une manifestation éclatante de ce même ordre cosmique, se répercutant sur toute la vie économique, religieuse et morale de l’empire. Tel était le processus de civilisation le long du Nil, il devait durer, avec plus ou moins de vicissitudes, presque trois millénaires ; telles aussi étaient les valeurs consubstantielles.
Simultanément, la civilisation mésopotamienne, quant à elle, mettait chaque cité sous la protection d’une divinité particulière, en cas de défaite militaire, le dieu de la cité vainqueur prenait la place du dieu vaincu. Comme l’indique la stèle d’Hammourabi exposée au Louvre, l’ordre social, même s’il est fait sous l’égide du dieu Shamash (le Soleil), est décrété par la seule volonté du roi. L’écriture, dans cette civilisation, avait pour fonction première de noter les richesses foncières, les troupeaux de moutons, les jarres de bière, les richesses envoyées aux temples,… C’est ainsi que les spécialistes, de nos jours, considèrent les tout premiers signes cunéiformes. Plus tard, mais bien plus tard, ces mêmes signes serviront à noter les prières et les épopées. Par ailleurs, dans cette civilisation, l’observation des étoiles qui allait devenir l’astrologie avait pour fonction essentielle et vitale de tenter de prévoir les crues des deux fleuves, par nature imprévisibles7. Là encore, le processus de civilisation englobant ces valeurs, et quelques autres encore, dura pendant des millénaires. En particulier, le système des cunéiformes, infiniment supérieur aux hiéroglyphes, se répandit dans tout le Proche-Orient. Il permit de noter des langues appartenant à des familles linguistiques très différentes, il était même en usage à la cour de Pharaon (cf. Lettres de Tell el Amarna).
Quant au processus de civilisation des Aztèques, il considérait comme une valeur primordiale l’union de la terre et de ciel, sous forme d’une conjonction du serpent et de l’oiseau (Quetzalcóatl). De cette union devaient résulter les pluies fécondantes nécessaires à la croissance des pieds de maïs, base de l’alimentation. Afin de mieux nourrir la terre par un aliment symbolique de premier ordre, les Aztèques s’adonnaient à des sacrifices d’êtres humains au cours desquels on prélevait le cœur encore palpitant des victimes. Ce cœur était présenté en hommage au soleil trônant au ciel, tandis que le sang, en se répandant sur la terre, était censé fertiliser le sol. Malgré l’horreur que cette pratique suscite ne nous, pour les Aztèques c’était l’expression d’une valeur dans laquelle s’incarnait leur processus de civilisation.
Je ne multiplierai pas davantage les exemples, cela nous entrainerait trop loin. Il faudrait examiner les processus de civilisation en Inde, en Chine et tous ceux qui existé en Afrique, en Asie, en Amérique ; et les valeurs qui leur sont afférentes. Je mentionnerai seulement la relation à la Terre, aux différentes plantes, aux roches, au paysage que les Canaques de Nouvelle-Calédonie entretiennent avec leur environnement et qui constitue l’essence de leur civilisation et la valeur principielle à quoi toutes les autres se rattachent, le système tribal, leur agriculture et les échanges économiques, les mœurs en général et la convivialité. Cette valeur, symbolique au plus haut degré, conditionne en fait toutes les autres valeurs de la civilisation canaque.
Je dirai néanmoins quelques mots sur une valeur qui eut son heure de gloire sur plusieurs points du globe dans de nombreuses civilisations, indépendamment les unes des autres, et qui fut peut être, dans celles du passé, la valeur dominante la plus répandue. Il s’agit de
7 L’Euphrate et le tigre, prenant leur source sur des pentes opposées de la même chaîne de montagnes, ont nécessairement une hydrologie indépendante et des régimes chaotiques, encore que, considérant leur longueur différente, ils puissent parfois avoir des crues conjointes et dévastatrices car imprévisibles. On pense même que ces crues ont pu donner l’idée du déluge décrit dans l’épopée de Gilgamesh laquelle fut copiée, bien longtemps après, par les rédacteurs du déluge biblique où s’illustra Noé.
l’anthropophagie. On connaît la multiplicité des explications de cette pratique déroutante, considérée par beaucoup comme barbare, apte à elle seule à exclure une société du rang des civilisations : appropriation, par ingestion, de la force de l’ennemi tué au combat, manque ou insuffisance de nourriture carnée, certitude que l’ennemi ingéré ne se réincarnera pas pour venir châtier son meurtrier, façon définitive et expéditive de tenir l’ennemi en sa possession, manière commode de ne pas s’encombrer de provisions au cours des expéditions guerrières, on se servira sur place !… et tout le bataclan des théories prétendument explicatives. Faisons confiance aux ethnologues, ce sont les champions des explications tous azimuts et de la recherche des raisons cachées. Il n’y a que les psychanalystes pour les battre. Et quand un psychanalyste se pique d’ethnologie, ou l’inverse, alors là, on obtient le sommet culminant des élucubrations !
Il est vrai que l’anthropophage fut longtemps considéré comme dépourvu de civilisation et inapte à être civilisé. Le processus de civilisation des peuples qui s’adonnaient à cette pratique de table, vue par un regard européen, avoisinait le zéro absolu. Les annotations du capitaine Cook, au cours de ses trois voyages dans le Pacifique, témoignent de cette répulsion. Nous pouvons y ajouter cette constatation d’une ironie macabre, quand on sait que ce même Cook succomba à ce triste sort, même s’il fut consommé, semble-t-il, que partiellement.
Pourtant, il y a quelques années, lorsqu’un journaliste demanda à un natif des Îles de la Sonde, cannibale dans ses jeunes années, pourquoi lui, ses congénères et tous ces ancêtres avant lui s’étaient adonnés à cette pratique si honnie, il obtint une réponse inattendue et fort déroutante. Était-ce pour s’emparer de la force de l’ennemi tué ? Sans l’ombre d’une hésitation et sans ambages, avec une candeur désarmante : « Ah ! Non, répondit l’homme interrogé, pour le goût ! » Ethnologues, vous voilà subitement retombés sur votre derrière, vous êtes sommés de réviser votre copie ! Ne cherchez plus la raison dans le symbolique, vous la trouverez dans le gastronomique, et vous n’y aviez même pas pensé !
EXISTE-T-IL DES VALEURS UNIVERSELLES ?
L’anecdote précédente, moins anecdotique qu’il y paraît, devrait nous inciter à une modestie plus clairvoyante. De quelles valeurs parlons-nous lorsque nous les associons aux processus de civilisation ? Certes, ce qui transparaît en filigrane dans la question initialement posée c’est l’existence présupposée d’une, ou de plusieurs valeurs pouvant se prévaloir du qualificatif universelles. Dans ce cas le processus de civilisation concernerait la promotion de ces valeurs au détriment de toutes les autres.
Quelles seraient alors ces valeurs universelles ? Serait-ce les valeurs économiques, ou les valeurs morales, ou politiques ? Certes il est particulièrement réconfortant, pour une pensée, de promouvoir, en les mettant en exergue, des valeurs telles que la liberté sous ses multiples formes, l’égalité des droits, la possibilité donnée aux gens de décider d’eux-mêmes de leur propre destin, la libre circulation des personnes et des biens, l’expression sans contrainte ni interdit des opinions de chacun y compris en matière de croyances, la volonté de tous de se soumettre à la loi, le respect d’autrui dans sa personne et ses biens, la promotion d’une gestion équitable et parcimonieuse des richesses naturelles, le souci de veiller à ne pas porter atteinte irrémédiablement et de nature irréversible à notre environnement… on pourrait continuer la
16
liste à satiété. La plupart de ces valeurs, pour ce qui concerne la civilisation occidentale qui est la nôtre, sont aisément tenues pour universelles. Mais est-ce vrai pour toutes les civilisations ? Beaucoup d’entre elles nous somment de ne pas leur imposer ces mêmes valeurs. Au nom de quoi devrions-nous les leur imposer ? Allons-nous agir comme les missionnaires, les colonisateurs d’antan, en leur imposant des valeurs qu’ils récusent ? Par ailleurs, de façon plus cruelle, force est de constater qu’aucune civilisation, ni la nôtre ni encore moins aucune autre, ne peut se prévaloir d’avoir atteint un seul de ces objectifs, d’avoir réalisé pleinement une seule de ces valeurs. Un exemple suffira à le montrer. Que dire de cette valeur certainement universelle puisqu’elle consacre l’égalité parfaite entre tous les individus d’une même société, sans distinction de sexe ? Nous-mêmes, ici, dans nos rangs, avons-nous su la mettre en pratique ? Évidemment non, mais cela ne nous empêchera pas de revendiquer la prétendue universalité des droits de l’être humain !
CONCLUSION
Tout ce que l’on peut souhaiter c’est que la promotion de ces valeurs tenues pour universelles demeure un idéal, même lointain. Dans ce cas, le processus de civilisation, dans sa marche vers l’avant, devait se fixer comme point de fuite, la mise en pratique de ces valeurs. Car une valeur vaut, non pas seulement parce qu’elle est un idéal, mais parce qu’elle instaure une nouvelle pratique dont la réalisation doit conduire à un épanouissement des hommes, dans leur existence personnelle comme dans leur vie collective. Le processus qui doit conduire une civilisation à un tel épanouissement pour les êtres humains qui y vivent est clair. Soit, si nous sommes pessimistes, nous dirons qu’il ne sera jamais atteint car trop utopique, trop lointain, trop rempli d’imprévu et la marche qui devrait nous y conduire, trop chaotique, nous sommes alors dans un pur constat d’échec ; soit, nous sommes optimistes et nous considérerons que le processus est en bonne voie, que la pierre brute, bien qu’à peine dégrossie, s’achemine vers la perfection, au fil du temps qui passe, jour après jour. Après un constat qui aurait pu nous conduire au découragement, nous devons répliquer par le désir d’aller de l’avant, de progresser, les yeux fixés vers l’horizon de l’idéal de perfection que constituent ces valeurs. Ainsi, au pessimisme de l’intelligence, nécessaire dans un premier temps, il convient de préférer l’optimisme du cœur, stimulé par notre volontarisme de rester debout malgré l’obstacle. N’a-t-on pas dit que ce qui fait la valeur de l’homme, c’est l’obstacle auquel il s’affronte : « l’homme se découvre quand il se mesure avec l’obstacle » (Saint-Exupéry).
ÉPILOGUE
Une chose a, depuis longtemps, suscité mes interrogations et même n’a jamais cessé de me tourmenter. Il s’agit de l’illusion que les hommes nourrissent à l’égard des valeurs de leur temps et de leur milieu. Ils considèrent ces valeurs comme ne devant jamais disparaître et durer jusqu’à la fin des temps, comme étant permanentes et inamovibles. Il est clair et évident que nous n’échappons pas, nous-mêmes, à cette illusion tenace. Pour comprendre cela, imaginons une expérience fictive.
17
Transportons-nous, par la pensée, dans la première moitié du premier siècle avant notre ère. Entrons dans la luxueuse villa de Tusculum8 où Cicéron, sur ses tablettes de cire, est en train d’écrire ses dialogues philosophiques appelés depuis Tusculanes, peut-être d’ailleurs dictait-il ses textes. Dans son scriptorium, approchons-nous de sa table. Il est sur le point de terminer sa 5ème Tusculane, intitulée: « La vertu suffit-elle à assurer le bonheur? ». Il nous faut l’interrompre. Tapons-lui discrètement sur l’épaule de laquelle tombent les plis de sa toge et engageons la conversation. Pour que la vraisemblance soit plus grande imaginons que ce visiteur inopiné soit son ami, le poète Titus Lucretius (Lucrèce).
« Cher Marcus Tullius, mon ami, je te savais ici, à Tusculum. J’ai quitté Rome car, ces derniers jours, c’était une vraie fournaise. Ici, au moins, la brise est fraîche. Permets-moi de venir interrompre la course de ton stylet sur la tablette de cire. En effet, il n’y a pas que la chaleur qui m’a poussé jusqu’ici. En fait, je voudrais te faire part d’un songe que j’ai eu, cela fait quelques nuits, lequel, depuis, ne cesse de me hanter. Je te demande seulement de me laisser parler jusqu’au bout, sans m’interrompre, quelles que soient les alarmes que mes paroles ne manqueront pas de susciter en ton cœur. Après que j’aurai parlé, mais après seulement, toi qui as écrit un De Divinatione (Sur la divination) et un De natura Deorum (La nature des dieux), tu me donneras alors ton sentiment. J’attends beaucoup de ta clairvoyance pour apaiser mon inquiétude.
« Dans mon rêve, j’ai vu cette villa, dans laquelle nous sommes, réduite en ruines. D’elle on ne retrouvera même plus pierre sur pierre, Tout aura disparu. Même le lieu où elle est bâtie aura disparu des mémoires humaines. Mais plus grave encore, j’ai vu également les quatre immeubles que tu possèdes à Rome, ta magnifique domus sur le Palatin, tout cela aussi comme monceaux de pierres. Il en allait de même pour ta villa du bord de mer, à Puteoli (Pouzzoles), à peu de distance de Neapolis (Naples). Sans doute ne l’ignores-tu pas, mais cette villa et toute la ville avec elle sont construites à l’intérieur d’un cratère d’où émanent des vapeurs pestilentielles, une des bouches des enfers.
« Mais tu ne seras pas le seul à souffrir de ces désastres, beaucoup d’autres avec toi subiront un sort identique. Rome en son entier, malgré sa fierté, avec le Capitole, le Forum, les nombreuses basiliques, le Sénat, les cirques où s’assemble la populace, tout sera balayé par le souffle puissant de l’histoire. Certes, tout cela ne se fera pas en un jour, de même qu’il a fallu plusieurs jours pour bâtir Rome. La destruction se fera lorsque les ans auront passé. Ni toi, ni tes enfants, ni les enfants de tes enfants ne verront cela, ni encore beaucoup d’autres après eux, mais, crois-moi, cela aura lieu ! À moins que mon rêve me trompe.
« Cependant, il y a plus grave encore pour ce qui te concerne particulièrement, et cela je l’ai aussi vu dans mon rêve. J’ai vu ta propre mort. C’était horrible ! J’ai vu ta tête coupée, cette tête qui a su penser d’aussi belles choses en méditant sur les écrits de Platon que tu vénères ; j’ai vu aussi tes mains coupées, ces mains qui ont su manipuler, par un art consommé, le stylus sur les tabulæ de cire vierge pour écrire ces plaidoiries qui sont ta gloire et les nombreuses lettres à ton ami Atticus. Cette tête, ces mains, toutes ces choses je les ai vues, exposées comme vile viande, près des Rostres, sur le Forum, là où se lève l’orateur haranguant les foules. Ce fut pour moi une vision d’horreur et vois, j’en frémis encore en te le racontant ! Personne ne pourrait imaginer que c’est ainsi que devrait périr le grand Cicéron, l’homme
8 Tusculum, ville antique située à une faible distance de l’actuelle ville de Frascati et à une trentaine de kilomètres de Rome, sur des collines, à quelques six cents mètres d’altitude. Dominant la plaine de Campanie, jouissant d’un climat plus clément avec des étés rafraîchis p ar le vent, beaucoup de riches Romains y avaient fait édifier de somptueuses villas, échappant ainsi aux canicules romaines.
public, celui dont la parole était redoutée au Sénat et qui a su rendre de si grands services à la vie politique de sa Cité.
« Écoute à présent, Marcus Tullius, écoute avec la plus grande attention car ce que je m’apprête à dire dépasse tout entendement. Moi-même, malgré la force du rêve, j’ai beaucoup de peine à le croire. Ce que mon rêve m’a permis de comprendre, c’est que cette langue que nous révérons par-dessus tout, cette langue que nous estimons avoir pu rivaliser avec celle de l’Attique et avec les meilleurs écrivains de la Grèce, cette langue était vouée à la disparition. Là où s’élève Rome, et même partout où nos armées ont remporté des victoires, sur cette immensité de terres, au-delà des mers et par-delà les montagnes, partout notre langue cessera d’être parlée, écrite, comprise. D’autres langues auront pris sa place dont beaucoup nous seront totalement incompréhensibles, pas un seul de leurs mots ne nous rappellera ce qui nous est le plus familier.
« Enfin, comble de l’horreur, plus aucun des dieux que toi et moi nous honorons, plus aucune des cérémonies qui nous sont chères, plus aucun de nos temples aux fières colonnades, plus aucune des coutumes héritées de nos pères, ni les jeux du cirque, ni les fêtes, ni les prêtres que nous connaissons, tout aura disparu. Il en sera de même de nos institutions dont nous sommes si fiers, au point de vouloir les imposer au reste du monde ; de nos lois qui sont le ferment de notre unité. Rien, il ne subsistera rien, même pas cette tablette sur laquelle tu viens d’écrire cette dernière Tusculane.
« Voilà, Marcus Tullius, voilà ce qui m’amène, voilà ce qui m’agite ! Que penses-tu de mon rêve ? Que dois-je en comprendre ? Ai-je raison de me montrer inquiet ? J’ai pour habitude de ne pas croire aux prédictions des rêves, mais on ne sait jamais ! »
—————————————-
« Mon cher Titus Lucretius, ton trouble m’émeut mais surtout il me chagrine. Est-ce ainsi que tu penses atteindre l’ataraxie, cette absence de trouble de l’âme recommandée par ton maître Épicure pour atteindre le bonheur ? Tu viens de le dire toi-même, il s’agit d’un rêve, d’un simple rêve. Es-tu si peu au fait des idées de ce même maître que tu célèbres pourtant si bien dans ton poème De natura Rerum (De la nature) pour accorder le moindre crédit à un rêve, à une chose sans consistance ? Ce n’est rien d’autre que le simulacre de la pensée, le simulacre d’un simulacre ? Si je me souviens bien, dans ce même poème, tu as même consacré beaucoup de vers à dénoncer la prétention des rêves pour ce qui est de la prédiction des choses du futur. N’est-ce point Épicure qui écrivait justement que ce qui doit arriver arrivera nécessairement lorsque les conditions s’en trouveront réunies ? Souviens-toi, je t’en prie, des leçons de ton maître à penser ! Maintenant, pour ce qui est du contenu de ton rêve, permets-moi de te faire remarquer qu’il est parfaitement incohérent, absurde, sans aucun répondant dans la réalité, même dans un futur très lointain.
» Écoute, mon cher Lucretius, ne sais-tu pas que le processus de civilisation qui nous anime est impérissable ! N’as-tu jamais songé que les valeurs qui sont les nôtres, depuis des siècles, sont gravées dans le marbre le plus dur! Rome a l’éternité devant elle. Les monuments qu’elle érige dureront autant, et même plus, que durera l’airain le plus dur. Bientôt la Gaule entière sera romaine et parlera comme nous, aura les mêmes dieux, les mêmes lois, les mêmes coutumes. Dans quelques décennies nous aurons atteint les rivages des brumes du Nord, les déserts de l’Afrique, les terres d’Espagne, celles de la Palestine et de l’Égypte. Partout nous allons apporter la Pax Romana. Crois-moi, l’avenir nous appartient ! Il est à nous ! C’est sûr, il
19
convient au sage de se fier au processus de civilisation qui engage toutes nos valeurs les plus chères. Voilà notre socle de granit, sur ce socle, il nous revient d’y bâtir notre avenir afin que rayonne notre civilisation !
———————————————–
« Comme d’habitude, tu dis vrai Marcus Tullius. Me voilà rasséréné et plus épicurien que jamais ! Je te remercie de m’avoir donné une belle leçon d’épicurisme, toi qui ne prises guère cette philosophie, que tu connais pourtant plus que quiconque. Mais, la route qui m’a conduit ici et la longueur de mon propos m’ont donné soif. J’aimerais que tu me fasses goûter ce vin si extraordinaire venu des vignes que tes esclaves font pousser sur les pentes fertiles du Vésuve, non loin de ta villa de Pouzzoles. Si cette ville est bâtie sur un volcan, au moins peut-on espérer que ta vigne du Vésuve sera épargnée. Cette montagne est un lieu très sûr, en hauteur avec une vue splendide sur le golfe, un bien impérissable, un vrai présent des dieux! D’ailleurs, pourquoi n’y ferais-tu pas construire une belle villa qui témoignerait de ta gloire amplement méritée et qui défierait les siècles, après avoir vendu celle de Pouzzoles ? En outre, comme tu l’as si bien dit, notre processus de civilisation est indestructible, sans doute comme le Vésuve ; et nous nous devons d’accorder un crédit illimité à nos valeurs impérissables ! ».
Mutatis mutandis, ce qui vient d’être dit dans ce dialogue entre Cicéron et son ami Lucrèce, serons-nous capables de l’appliquer à nous-mêmes en visant notre processus de civilisation ? Et nos valeurs seront-elles assez irréfragables pour résister aux assauts de l’histoire, aux aléas du temps ? Qui pourrait répondre par l’affirmative à toutes ces questions ? Notre optimisme ne nous aveugle-t-il pas, comme celui de Cicéron aveuglait l’homme clairvoyant qu’il se piquait d’être ?
Robert LLOANCY
Réveil du Béarn PAU (Nov. 2012)