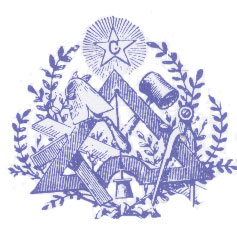Au bout de l’enquête le crime
La rumeur publique présente parfois la FM comme une association de malfaiteurs tramant dans l’ombre de noirs complots ou édifiant des temples au vice. En fait, ces bruits restent en-dessous de la vérité, car nos réunions se déroulent toujours sous le signe du crime.
Au bout de l’enquête, le crime
La rumeur publique présente parfois la FM comme une association de malfaiteurs tramant dans l’ombre de noirs complots ou édifiant des temples au vice. En fait, ces bruits restent en-dessous de la vérité, car nos réunions se déroulent toujours sous le signe du crime. L’initiation en offre le versant violent, puisque le profane, coupé de son milieu, jeté dans une geôle, se voit sommé de rédiger son testament, puis de subir la mise à mort de son moi ancien. Malmené par toute une série d’épreuves, purifié malgré lui par tous les éléments, traîné en aveugle, menacé de tous côtés, il doit avaler une coupe amère, se faire marquer au fer rouge, consentir à verser son sang. Et avant de se trouver ébloui par la grande lumière, il aura dû, lors de la petite lumière, affronter le spectacle d’un corps gisant dans la pénombre, celui de son double en traître exécuté par les justiciers de l’ordre. Simple figuration atténuée de pratiques ancestrales plus sanguinaires, nous rassure le rituel… Cela reste à voir.
En fait, cette cérémonie met le point d’orgue à une procédure tout aussi impitoyable : celle des enquêtes et des auditions. Pourquoi ce recours à une méthode encore tout imprégnée des mauvais souvenirs de l’Inquisition ou du stalinisme ? Pour sonder le cœur et les reins du candidat, sans doute, pour tester sa santé, sa solidité, sa détermination ; pour évaluer la pureté de ce futur maillon éventuel. Mais aussi, plus profondément, pour le mettre en face de sa part de mort, faite de corruption, de compromission, d’impureté, et pour éveiller en lui le sens de la responsabilité sans lequel aucun progrès ne serait possible. Le prototype de toute enquête future nous vient en effet d’une lointaine tragédie de Sophocle où Œdipe prend l’initiative de ce dépistage policier avant la lettre dont il sera la première victime. Comme Œdipe, l’apprenti devra apprendre à cheminer en aveugle, à chercher en tâtonnant le secours d’une main ou l’appui d’une épaule. Il devra aussi assumer le corps du délit, cette pierre brute sur laquelle il devra travailler, formant désormais le territoire de son analyse scientifique ou philosophique.
La phase critique des enquêtes a pour vocation de passer le candidat au crible, de le cribler de questions, de le cerner. La phase de l’initiation, elle, se propose de l’incriminer, de le confronter à une crise, de le mettre au secret, jusqu’au moment où l’hésitation fait place à la certitude. Alors le candidat cesse d’appartenir au monde et même de s’appartenir (comme le dit justement le rituel), pour entrer au sein de la loge. Tous les mots-clés de cette opération (« cribler, cerner, incriminer, crise, certitude, secret ») partagent l’étymologie du mot crime, liée à la notion de clivage : originellement, le crimen latin désigne le jugement du tribunal par lequel un être est séparé de ses semblables. Non seulement l’apprenti est reçu après avoir été mis à part, mais il devra s’initier lui-même à l’art de la discrimination.
Nous tirons tous notre origine d’un crime. Les théologiens l’imaginent comme une chute dans une faille : en allemand, ils expliquent Sünde, le péché, par Sonderung, la séparation ; en anglais, sin par sunder. Un sevrage, dans tous les cas. Nous, les Maçons, nous inscrivons dans cette logique issue de la Genèse, quand nous revendiquons l’héritage de Caïn, le criminel fratricide, et de sa descendance : Hénoch le bâtisseur, Tubalcaïn l’artisan forgeron, Naamah la belle et toute cette lignée de rebelles dont les cités babéliennes jettent un défi au Ciel. Car notre civilisation naît au moment où notre main se dote d’un instrument servant à la fois d’arme et d’outil, comme le montre magistralement Stanley Kubrick au début de 2001, L’Odyssée de l’espace. Pour avoir refusé l’éternité et choisi le progrès, nous sommes marqués et nous sommes contraints à l’exil perpétuel, de fondation en fondation, d’errance en errance, entre fuite en avant et escalade dans la transgression (comme le héros de Jean-Luc Godard Pierrot le fou, ou les tueuses de Claude Miller dans Mortelle randonnée). Pour l’Église, la vie tout entière se présente comme un couloir de la mort, une vallée de larmes, une enfilade d’exactions et d’expiations.
Le premier crime préside à la naissance, au sevrage du monde et des corps perpétré par l’Éternel Séparateur. Le deuxième crime advient avec la conscience, le clivage intérieur : il est accompli par la Femme ou la Vie, inspirée par le grand Diviseur Satan et il conduit à l’exil d’Eden. Le troisième crime intervient avec le meurtre du frère : il signe l’avènement de la conscience morale, car les voix du sang versé demandent justice, et il se paie d’un redoublement de l’exil. Désormais, le châtiment n’est plus simplement subi de l’extérieur : il est intériorisé et le coupable devient son propre punisseur.
Ce geste fatal consacre l’entrée de l’homme dans les tourments et la tourmente de l’Histoire. Dans les mythologies, toute fondation est ainsi baignée de sang : celle de Rome dans la légende ou celle de Macondo dans le roman de Gabriel Garcia Marquez, Cent ans de solitude. Le meurtre initial trace une limite dans l’espace et le temps et, simultanément, il instaure le mécanisme de la transgression, de l’interdit et du châtiment. Il reflète un choix et impose une décision. Et ce choix n’est pas uniquement personnel : celui de Caïn illustre ainsi la révolution néolithique, la maîtrise de l’espace et du temps par les techniques agricoles et on comprend pourquoi il déplaît au Seigneur, plus attaché au maintien de l’homme dans un état de dépendance à la nature, illustré par Abel le berger. L’Éternel ayant marqué sa préférence pour les viandes cuites par Abel et son peu d’intérêt pour le plat de légumes cuisiné par Caïn, ce dernier répond à la discrimination par le crime. Il a choisi son camp, celui des réprouvés. Mais en fait, il n’existe jamais de bon choix : tout choix est funeste, dans la mesure où il implique un rejet, des regrets ou des remords.
Dans une perspective existentielle, pourtant, nous ne devons pas déplorer cette apparition des remords. Sans eux, l’histoire serait réduite à un perpétuel bégaiement et ne pourrait progresser. Les Grecs leur donnaient l’apparence de divinités impitoyables, appelées Érinyes, ou « persécutrices ». Mais (comme le rappelle Eschyle dans l’Orestie), on peut aussi les nommer Euménides ou « Bienveillantes », non seulement pour s’attirer leur clémence, mais encore pour souligner le caractère positif de leur rôle. Car elles sont les auxiliaires précieuses de la Justice, Thémis, et si elles sévissent, c’est contre le mal. Les Romains les peignent sous les traits des Furies, harcelantes comme ces mouches dont Jean-Paul Sartre saura se souvenir dans une de ses pièces.
Cette vision classique fonde le schéma ternaire de la tragédie grecque : l’homme transgresse un interdit, la vengeance divine le punit et, sa peine purgée, il intègre un ordre renouvelé. L’institution judiciaire et pénitentiaire a normalement pour fonction de restaurer ce lien rompu entre le criminel et la société dont il s’est exclu. Comme l’explique Pierre Legendre, dans un petit essai intitulé « L’homme en meurtrier », le procès a pour but essentiel de séparer le coupable de son acte et de l’amener à rejoindre le monde des hommes, à retrouver le chemin de l’humanité. Et, selon lui, ce retour passe par la reconstruction de l’image du Père, garant de la Loi, à l’ombre de laquelle tout humain doit apprendre à vivre sa condition d’être séparé.
En FM, nous évoquons volontiers le meurtre symbolique du Père par lequel le néophyte finit par se libérer de la tutelle de son maître initiateur, afin de voler de ses propres ailes. Mais cette autonomie ne doit pas se confondre avec l’indépendance. L’apprenti trop pressé de se libérer de l’héritage de ses aînés risque fort de connaître le sort d’Icare. La vie humaine ne peut se développer sans lois. Freud puis Marcuse l’ont bien montré : après avoir tué le Père, les Fils révoltés se trouvent à leur tour à la place du Père et, pour se soustraire à la pulsion meurtrière de la génération suivante, ils doivent instaurer le principe d’une répression intériorisée, dont l’efficacité de tous les instants dépasse celle de la Loi imposée de l’extérieur.
Si, de façon prévisible, le patriarcat focalise toute son attention sur le parricide, il sous-estime en revanche les autres formes de meurtre : fratricide, sororicide, matricide, filicide, uxoricide, suicide. Pour mettre un terme à la pratique rituelle des mises à mort d’un enfant par son père, l’Éternel attend jusqu’à Abraham : il se décide alors à interrompre le sacrifice d’Isaac, dont il était le commanditaire. Pour proscrire le meurtre, il attend Moïse, auquel il remet ses Tables de la Loi, où l’interdiction de tuer figure d’ailleurs seulement en sixième position, bien après celle de tailler des idoles. Cela ne l’empêche pas, peu de temps après, de demander à Josué d’exterminer jusqu’au dernier les habitants de Jéricho, hommes, femmes, enfants, veaux, vaches, cochons, couvées… Et il donne sans cesse le bon exemple en tuant quiconque lui déplaît, en détruisant les cités ou les peuples, quand il n’annihile pas l’humanité tout entière. Les divinités paternelles sont souvent de grands sanguinaires : comme le rappelait Anatole France, les Dieux ont soif.
Ainsi donc, le crime de la Genèse coïncide avec la Genèse du crime. En exilant l’homme originel dans l’univers des mortels, le Créateur le contraint à tuer pour vivre dans cette nature où tous les êtres se dévorent pour se nourrir, selon un mécanisme auquel i! est impossible de se soustraire, même en adoptant une position végétarienne, puisque manger deux grains de riz, c’est encore tuer deux grains de vie. Le Livre sacré offre également le modèle de tous les meurtres à grande échelle, des génocides accomplis sur la recommandation expresse de Dieu, ou par son Ange Exterminateur, ou de sa propre main. L’Apocalypse constitue à cet égard le prototype de la solution finale dont le peuple élu fut à son tour la victime dans l’histoire plus récente.
De nombreux meurtriers se sont sentis encouragés par ces images de massacre hyperbolique. À Simon de Montfort, le pourfendeur catholique des cathares, on prête cette phrase expéditive : « Tuez les tous ! Dieu reconnaîtra les siens ». Mais les grands exterminateurs ne se perçoivent pas comme meurtriers : agissant au nom des .grandes causes de l’Église ou de l’État, ils se nomment purificateurs, voire pacificateurs. Ils se sentent protégés par l’énormité de leurs actes ; ils s’exemptent des lois communes, tels tes grands dictateurs. Ils s’arrogent un statut légendaire de tueurs mythologiques, tel Héraclès, meurtrier dès son plus jeune âge, et tant d’autres héros guerriers auteurs de mémorables boucheries. Ils se mettent en marge de la société et de l’état civil, tels les agents secrets double zéro, détenteurs d’un « permis de tuer », ou ils achètent même leur visa pour l’au-delà tels tes kamikazes du terrorisme moderne.
Se mettre ainsi hors la loi, c’est, s’accorder un statut d’exception, et cette tentation explique sans doute pour une large part la fascination exercée par les grands criminels. Je me rappelle moi-même, tout jeune, avoir cédé à cet attrait populaire quand, à la dernière page de France-Soir, celle des bandes dessinées, je délaissais la colonne de gauche consacrée aux « Amours célèbres » pour me repaître de la colonne de droite, plus virile, intitulée « Le crime ne paie pas », dans laquelle s’étalaient les exploits d’Al Capone et autres maffiosi de l’époque des Incorruptibles, avec une mention spéciale pour Johnny Dillinger, pour sa manière de narguer la police. À cette époque-là, j’aimais les marginaux rebelles à la loi commune, tel Arsène Lupin, et si j’appréciais un auxiliaire de l’ordre comme Sherlock Holmes, c’était pour les mêmes raisons, à savoir son caractère radicalement asocial. Avec le temps, la frontière entre les flics et les criminels a d’ailleurs continué de s’estomper, comme dans le personnage de Dirty Harry, l’inspecteur aux manières expéditives, flirtant avec l’anarchisme de droite, comme tous les justiciers de cette période (du genre Charles Bronson). Avec le recul, je comprends mieux la spécificité des criminels du XXe siècle. Ils se distinguent de tous leurs prédécesseurs par un élément de taille : la mort de Dieu, constatée par Nietzsche à la fin du XIXe siècle, dont la conséquence avait déjà été énoncée par Dostoïevski, l’auteur de Crime et Châtiment : désormais, « tout est permis ». Entendons-nous : cette formule émancipe l’homme de la loi et de la justice divines, mais elle lui assigne en contrepartie la tâche de fixer lui-même les valeurs selon des critères humanistes, et de ce fait, comme le disait Sartre, « nous sommes condamnés à être libres ».
En dehors de cette revendication de marginalité par rapport à la loi, existe-t-il d’autres motivations au crime ? De toute évidence, oui. Et l’une des principales a partie liée avec la sexualité. Le meurtre offre sans doute une forme d’assouvissement comparable à l’orgasme et, très souvent, ils sont associés, ou l’un se substitue à l’autre. Dans un roman de Jean-Patrick Manchette, intitulé Ô Dingos, ô châteaux ! (ou Folle à tuer), un exécuteur trouve l’apaisement de ses douleurs d’estomac seulement au moment d’envoyer ses victimes dans l’autre monde. La jouissance de détruire l’autre dans un corps à corps mortel fait partie de la littérature (autour de Gilles de Rais ou de Barbe-Bleue), mais aussi des faits divers liés au viol ou parfois à la possession amoureuse. L’individu à peu près normal se contente de mimer quelques actes cannibales, en mordillant le lobe de l’oreille de sa partenaire ou en lui donnant des petits noms comme « mon canard en sucre », sans chercher pour autant à l’engloutir. Mais l’individu pathologique passe au stade littéral, comme ce Japonais emprisonné à Paris voici une dizaine d’années, pour avoir découpé sa partenaire en morceaux et l’avoir ensuite accommodée sous forme de petits plats ; il a été libéré depuis et sa célébrité lui rapporte gros, au Japon où il doit, je suppose, avoir fait carrière dans la gastronomie. Là encore, ces personnages, loin d’être exceptionnels, se situent dans le droit fil de l’orthodoxie, puisque, dans la Genèse, l’invention de la mort coïncide avec celle de la sexualité, cette dernière étant par définition l’art de découper en morceaux.
Rien d’exceptionnel, donc, dans cette alliance de l’instinct de vie et de l’instinct de mort, d’Éros et Thanatos (pour reprendre la terminologie freudienne). La vogue américaine de l’hémoglobine au cinéma, dans les films gore, en offre la version débile, associant la déficience mentale et la déviance sexuelle, depuis Massacre à la tronçonneuse jusqu’aux Scream, Vendredi 13 et autres Halloween, et elle débouche régulièrement sur les carnages répétés dans les écoles ou les universités. Les blessures narcissiques et l’incapacité à affronter l’autre dans une relation d’échange conduisent à la recherche de la jouissance dans le meurtre. Bien des criminels instinctifs gardent ce primitivisme de la brute dont nous n’arriverons jamais vraiment à effacer la trace. Mais quand cette sauvagerie se combine avec un grand raffinement, l’horreur interpelle plus encore : la littérature du marquis de Sade, le personnage de l’intellectuel cannibale, Hannibal Lector, dans Le Silence des Agneaux, mais aussi (comme le rappelle Alejo Carpentier dans Le Partage des eaux) la barbarie froide des bons pères de famille allemands se délectant de la musique de Mozart à une encablure des fours crématoires.
Le crime dit le retournement de l’amour en haine, comme dans la famille des Atrides dont se sont inspirés nos tragédiens classiques. Bien des meurtriers tuent pour répondre à un manque d’amour, comme la créature de Victor Frankenstein, abandonnée par son géniteur, ou ce jeune paysan normand racontant en 1835 un récit intitulé Moi, Pierre Rivière, ayant égorgé ma mère, ma sœur et mon frère, analysé par Michel Foucault et porté à l’écran, ou encore Violette Nozière, dont le parricide, filmé par Chabrol, défraya la chronique en 1933 (deux de ses enfants étaient en classe avec moi, sous un autre nom). Au cinéma, le crime peut même devenir un lien affectif, d’ordre filial (dans Nikita ou Le Chemin de Perdition), d’ordre fraternel (dans Aniki, mon frère, de Takeshi Kitano) ou d’ordre conjugal (dans Bonnie and Clyde).
Quand l’amour fait défaut, alors l’homme cherche à s’exterminer lui-même : il se bat en duel avec son double, comme le « William Wilson » d’Edgar Poe, il décharge son revolver dans son propre reflet, comme dans Zardoz, ou il entre dans une spirale d’autodestruction, comme le consul alcoolique peint par Malcolm Lowry dans Sous le volcan. Le suicide n’est pas un crime, m’objecterez-vous ? Erreur, s’il n’est plus considéré comme tel, c’est extrêmement récent. Dans l’antiquité grecque, le suicidé était déchu et enterré loin de la cité. Au Moyen Age, dans la Divine Comédie de Dante, il allait croupir dans le septième cercle de l’Enfer. Sous Louis XIV, en 1670, son cadavre était traîné dans les rues, face contre terre, puis jeté aux ordures. Au Royaume-Uni, jusqu’en 1961, son geste était sanctionné par la confiscation de tous les biens, et le même verbe, « commettre », s‘appliquait au suicide, au vol et au meurtre. Jusque dans les années 1990, dans certains états des USA, les auteurs d’une tentative de suicide devaient comparaître devant le tribunal. C’était également le cas en Inde jusqu’en 1994 et, aujourd’hui encore, à Singapour, le rescapé est passible d’un an de prison.
Gardons-nous de croire à l’universalité des définitions du crime. Elles varient selon les cultures et les époques. Combien de femmes sont encore lapidées, brûlées, mutilées, sans entrer dans les statistiques du crime ! Combien de meurtres reçoivent encore l’approbation sous l’appellation de « crimes d’honneur » ! L’anthropologue Claude-Lévi-Strauss croyait pouvoir discerner dans la prohibition de l’inceste le tabou universel sur lequel s’édifiait toute civilisation. C’était ignorer un multitude d’exceptions dans le monde et nombre de passages de la Bible où cette pratique est non seulement tolérée, mais approuvée par Dieu[1]. En France, depuis la Révolution, le mot « inceste » ne figure plus ni dans le code civil ni dans le code pénal. Le lien de parenté est seulement une circonstance aggravante dans les atteintes ou agressions sexuelles, mais, en dehors de ces cas, la pratique incestueuse ne fait pas l’objet d’une infraction spécifique. La cérémonie du mariage chrétien montre d’ailleurs symboliquement ce droit de préemption implicite du père sur la fille, même s’il a l’amabilité de la rétrocéder à son gendre, au lieu de se dire, comme certains : « Je me la suis faite, je me la garde ».
De même, chaque époque a ses crimes préférés : aujourd’hui le parricide est out ; le crime de pédophilie est très in, en réaction à l’engouement des années 1980. Hier, entre autres, Henri Tachan pouvait chanter : « Laissez venir à moi les petit’es « fans », / Les bras ouverts, le slip entre les dents,/ Les petites de 7 à 17 ans… ». Aujourd’hui, avec la même chanson, il aurait de sérieux ennuis. Par ailleurs, dans une même culture, tous les crimes ne se valent pas : chez Fritz Lang, par exemple, le diabolique Docteur Mabuse finit éclipsé par M le maudit, le paria absolu, réprouvé et traqué par la pègre, comme certains criminels odieux sont malmenés par leurs codétenus dans les prisons. Mais, s’il existe de vilaines exactions, existe-t-il en contrepartie de beaux crimes ? Le romantique De Quincey avait abordé cette question de l’esthétique sous un titre provocant : De l’assassinat comme un des beaux-arts, et, plus récemment, le cinéaste Peter Greenaway peignait son Meurtre dans un jardin anglais comme un paysagiste et l’agençait comme un joueur d’échecs. Le véritable intérêt ne réside plus dans le sang versé, mais dans la résolution d’une énigme. Tel est le ressort de tous les romans policiers, d’Edgar Poe à Conan Doyle ou Agatha Christie.
Mais cette conception fermement ancrée dans la causalité, selon laquelle il suffit de détecter des indices et de collectionner des motivations pour remonter la piste jusqu’au criminel, commence à dater sérieusement. Depuis les grands holocaustes, nous sommes entrés dans l’ère de l’absurde. Le crime peut devenir aléatoire, frappant au hasard comme la roue de Fortune. Le meurtre peut être un acte gratuit, comme celui de Lafcadio, Les Caves du Vatican de Gide, quand il décide sans motif de précipiter un parfait inconnu sous un train. Un accusé peut devenir coupable sans connaître son crime, comme chez Kafka, ou être persuadé d’avoir commis un crime de la pensée forgé de toutes pièces, comme chez Orwell. Un coupable peut être accusé d’un vrai crime et condamné pour un autre, fantasmatique, comme L’étranger d’Albert Camus. Alors, direz-vous, pourquoi continuer à raconter toutes ces histoires ? Pourquoi, sinon pour suspendre et peut-être exorciser l’inéluctable, telle Shéhérazade dans Les Mille et une nuits, pour maintenir le fil ténu de la vie par celui du récit.
Aujourd’hui, les chamarrures des crimes à l’ancienne ne nous émeuvent plus. Sur son écran de télévision, le citoyen ordinaire peut aisément regarder d’un œil distrait les corps réduits en charpie par des attentats quotidiens, tout en se resservant une assiettée de tripes à la mode de Caen. Il observe avec détachement les carnages du monde, comme s’il s’agissait d’une scène des Tontons flingueurs. Le pseudo-réalisme médiatique a fini de déréaliser toutes les aventures physiques et d’exténuer toutes les sensations. Il est désormais occupé à parachever l’ultime crime, invisible et sans traces, contre l’intelligence. Un crime immaculé et imprescriptible, contre les valeurs essentielles de la vie. Souhaitons ne jamais voir ce crime parfait. Et, pour conjurer le mauvais sort, lisons en guise de conclusion cet antidote contre la connerie, « Le Sultan » de Jacques Prévert :
Le Sultan
Dans les montagnes de Cachemire
Vit le Sultan de Salamandragore
Le jour il fait tuer un tas de monde
Et quand vient le soir il s’endort
Mais dans ses cauchemars les morts se cachent
Et le dévorent
Alors une nuit il se réveille
En poussant un grand cri
Et le bourreau tiré de son sommeil
Arrive souriant au pied du lit
S’il n’y avait pas de vivants
Dit le sultan
Il n’y aurait pas de morts
Et le bourreau répond D’accord
Que tout le reste y passe alors
Et qu’on n’en parle plus
D’accord dit le bourreau
C’est tout ce qu’il sait dire
Et tout le reste y passe comme le sultan l’a dit
Les femmes les enfants les siens et ceux des autres
Le veau le loup la guêpe et la douce brebis
Le bon vieillard intègre et le sobre chameau
Les actrices des théâtres le roi des animaux
Les planteurs de bananes les faiseurs de bons mots
Et les coqs et leurs poules les œufs avec leur coque
Et personne ne reste pour enterrer quiconque
Comme ça ça va
Dit le Sultan de Salamandragore
Mais reste là bourreau
Là tout près de moi
Et tue moi
Si jamais je me rendors.
J. Prévert
Paroles, Paris, Gallimard, 1949, Folio, p. 193.
[1] – La descendance d’Adam et Eve, celle de Noé. Les filles de Loth. Juda et Tamar.
Lu le 01/02/2008 | Apprenti
Ajouter au favori